Le parcours d’Idrissa vers la régularisation

En 2017, Idrissa pose ses valises à Paris. Il n’imaginait pas à quel point sa route vers la régularisation et la stabilité serait semée d’embûches. Malgré ses nombreux efforts d’intégration, la préfecture a refusé implicitement sa demande d’admission au séjour. Cinq ans d’ancrage sur le territoire français Idrissa Maoui, originaire du Mali, décide de quitter son pays natal dans l’espoir d’un avenir meilleur en France. Au mois de décembre 2017, il pose ses valises dans la capitale où il cherche rapidement un emploi pour subvenir à ses besoins. Le 1ᵉʳ août 2020, Idrissa décroche un travail à temps plein en qualité de serveur dans un restaurant parisien. Ce CDI lui permettait de percevoir un salaire équivalent au SMIC, qui, par la suite, a été réévalué à 2200 euros. Après cinq ans de résidence ininterrompue sur le sol français, Idrissa prend son courage à deux mains pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il signe le contrat d’engagement au respect des principes de la République et rassemble tous les documents nécessaires pour constituer son dossier : Les jours et les semaines se sont succédé après le dépôt du dossier de demande d’Idrissa à la préfecture de police. Malheureusement, aucune réponse ne lui a été délivrée. Un refus implicite était survenu après la fin du délai réglementaire de 4 mois. Une argumentation solide et irréfutable Idrissa a fait appel au cabinet d’avocats en droit des étrangers pour plaider sa cause auprès des autorités compétentes. Après un examen détaillé de son dossier, le cabinet envoie une demande d’explication de ce refus aux autorités préfectorales qui se sont abstenues de répondre. Ce silence administratif démontrait l’absence de motivation de la décision défavorable et l’erreur d’appréciation du dossier de cet étranger. Pour défendre les droits de ce trentenaire, le cabinet a décidé de porter l’affaire en justice. L’argumentaire était solide. Il se basait sur la situation et le parcours exemplaire d’Idrissa en France. Durant ses 5 années de vie dans l’Hexagone, ce ressortissant malien n’a jamais failli à ses obligations. Il a appris le français, disposait de revenus stables, payait toujours ses impôts et ne dérangeait personne. Les liens qu’il a noués tout au long de son parcours prouvent son intégration à la communauté française. De plus, ses supérieurs reconnaissent volontiers son sérieux et son engagement. Une victoire amplement méritée À l’issue de la saisine, le juge avait tranché en faveur d’Idrissa. Le tribunal administratif a ordonné à la préfecture de lui accorder un titre de séjour sous peine d’astreinte financière. Idrissa a également reçu la somme de 1000 euros pour couvrir les frais relatifs à sa défense. Pour ce ressortissant malien, cette victoire va bien au-delà du cadre administratif. Une nouvelle vie, teintée d’espoir et de quiétude, s’ouvrait à lui.
Le combat de Stella : un avenir menacé par un refus de renouvellement de carte de séjour

Stella Ndjomo, 45 ans, a quitté le Cameroun en 2012 pour reconstruire sa vie en France. Rien n’a été simple à son arrivée sur le territoire. Des petits boulots, des chambres exiguës, une langue à maîtriser. Mais Stella a fini par s’intégrer au fil des années. Chaque année, elle se devait de régulariser sa situation pour avoir le droit de rester, mais un jour, la préfecture de Lille lui a opposé un refus implicite. Des mois d’attente… Comme tous les ans, Stella dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour à la préfecture lilloise en 2022. Elle a réuni toutes les pièces justificatives pour appuyer sa demande. Mais aucune réponse ne lui était parvenue des mois après le dépôt de son dossier. Ce silence, une fois le délai réglementaire dépassé, équivaut à un refus implicite. Pourtant, Stella pensait avoir fait tout ce qu’il fallait, comme à son habitude. Confuse et désemparée, elle a fait appel au cabinet d’avocats en droit des étrangers pour contester la décision défavorable. Un dossier en pur béton Stella n’a jamais lésiné ses efforts pour s’intégrer à la société française, tant au niveau professionnel que social. Depuis 2012, elle a appris le français, décroché un diplôme en sécurité incendie, payé ses impôts, participé à la vie associative locale et a noué des liens amicaux. Elle a occupé plusieurs postes : vendeuse, téléconseillère, garde d’enfants, agent d’entretien. Elle a travaillé dans – au moins cinq – structures différentes et possède une ancienneté continue de plus de trois ans dans l’emploi. Sa vie est ici. Elle partage son quotidien avec une famille d’accueil qui la considère comme l’une des leurs. Son intégration ne fait aucun doute. Un recours pour exister Après un examen approfondi de la situation de Stella, le cabinet d’avocats experts en droit des étrangers a demandé à la préfecture de communiquer les motivations de ce refus implicite, mais celle-ci est restée silencieuse. Faute de réponse, le cabinet a décidé de former un recours contentieux auprès du Tribunal administratif afin de démontrer l’absence de motivation de la décision et de permettre à Stella d’obtenir ce qui lui revient de droit. La défense de cette ressortissante camerounaise s’appuyait sur des fondements solides dont son parcours sur le sol français, ses efforts d’intégration et des arguments juridiques aussi pertinents les uns que les autres. Le juge, après avoir examiné toutes les preuves, a finalement décidé de trancher en sa faveur. Le Tribunal administratif a ordonné à la préfecture de délivrer à Stella un titre de séjour conforme à sa situation, faute de quoi une pénalité financière pourrait être appliquée. Cette femme a également reçu une indemnisation financière de 1000 euros pour couvrir ses justices. Après des mois d’incertitude et une longue bataille juridique, Stella pouvait enfin respirer. C’était le début d’une nouvelle vie empreinte de sérénité.
Un rêve français en sursis : le combat de Pascal

Pascal Diouf est arrivé en France en 2018. Il nourrissait le rêve de s’installer en France depuis son plus jeune âge. Il savait que le combat serait dur, mais il était prêt à relever le défi, surtout maintenant qu’il a une famille. Installé chez un ami dans la métropole niçoise, il enchaîne les petits boulots avant de décrocher un CDI dans une entreprise de ventilation. Mais sa vie bascule lorsque la préfecture a refusé implicitement sa demande d’admission au séjour. Une démarche légitime, une réponse absente Depuis son arrivée sur le territoire Français, Pascal travaille sans relâche, déclare ses revenus, paie ses impôts et s’intègre dans la société sans déranger qui que ce soit. Il apprend le français, tisse des liens d’amitié avec ses collègues, participe à la vie sociale de son quartier. Après cinq ans, Pascal prend son courage à deux mains et dépose une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Nice. Il fournit toutes les pièces exigées : preuves de sa résidence ininterrompue, bulletins de salaire, attestation de son employeur. Il ne demande pas de faveur, seulement que sa situation soit examinée à sa juste valeur. Mais le temps passe. Aucune réponse ne lui parvient. Ni convocation, ni courrier, ni décision explicite. À l’issue du délai réglementaire de quatre mois, un refus implicite a été constaté. Un recours pour être entendu Loin d’être découragé, Pascal a sollicité le cabinet d’avocats en droit des étrangers pour faire entendre sa voix. Faute de réponse à une demande d’explication adressée à la préfecture, le cabinet a porté l’affaire devant le tribunal administratif pour contester ce rejet non motivé. L’argumentaire est clair et appuyé par des preuves solides : De plus, son employeur appuie fermement sa demande de régularisation, mettant en avant sa contribution précieuse au sein de l’équipe. Certes, Pascal ne dispose pas de proches parents en France, mais il a su créer des liens solides. Sa vie s’est bâtie ici, entre le travail et le quotidien, entre les difficultés surmontées et les moments simples partagés avec ses collègues. Ce sont ces liens sociaux, cette stabilité, cette contribution économique et humaine qui justifient son intégration à la société. Face à tous ces facteurs, le juge a décidé d’accorder un titre de séjour et une indemnisation financière de 1000 euros à Pascal. Pour lui, cela était bien plus qu’une victoire administrative. Il pouvait enfin respirer et continuer à vivre sereinement sans peur d’être expulsé. Son parcours reflète celui de nombreux étrangers en France. Des hommes et des femmes qui vivent, travaillent et gardent espoir, mais se heurtent aux rouages administratifs. Leur lutte ne vise pas à défier la loi, mais à faire valoir leurs droits.
Les dix ans d’intégration de Mélodie balayés d’un revers administratif

Mélodie n’avait que 20 ans lorsqu’elle pose le pied sur le sol français. Elle n’avait qu’un seul objectif : construire un avenir digne fait de stabilité et de dignité. Venue d’Algérie, elle ne comptait ni sur la chance ni sur les raccourcis. Ce sont ses efforts, ses diplômes et sa volonté inébranlable qui ont défini son parcours. La rage de réussir À son arrivée, Mélodie a intégré un programme universitaire exigeant afin de préparer un Master en études anglophones sur le campus de Bobigny. En parallèle, elle enchaîne divers emplois pour assurer sa subsistance. Elle est aide-ménagère, nounou et aide à domicile entre deux cours. Au fil des années, cette jeune femme algérienne gagne l’estime de ses employeurs, de ses professeurs et de ses amis. La France devient alors pour elle un véritable foyer. Des preuves d’intégration irréfutables Après douze ans d’intégration et de résidence ininterrompue en France, Mélodie voit son avenir basculer. La préfecture ne lui avait donné aucune réponse quant à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour après le délai réglementaire de 4 mois, ce qui a donné lieu à un refus implicite. Pourtant, elle pensait avoir tout fait dans les règles. Elle a appris la langue, rassemblé tous les documents nécessaires pour justifier sa demande : fiche de paie, attestation de travail, justificatifs de domicile, factures… Cette décision mettait en péril son avenir dans ce pays qui est pour elle, bien plus qu’une terre d’accueil. Elle voyait ses efforts réduits en poussière. Pour plaider sa cause et défendre ses droits, Mélodie fait appel au cabinet d’avocats spécialisés en droit des étrangers. Un combat administratif pour obtenir le droit de rester sur le territoire français Dans un premier temps, le cabinet a adressé une requête à la préfecture de Bobigny afin d’obtenir les motifs du refus implicite. En l’absence de réponse, il s’est résolu à saisir la justice pour contester cette décision insuffisamment motivée et entachée, selon lui, d’une erreur manifeste d’appréciation du dossier de son client. Son argumentaire se basait sur la situation et le parcours de Mélodie en France : plus de 10 ans de résidence, 9 ans d’activité en tant que salarié, maîtrise du Français, situation de non-polygamie. Après maints débats, le Tribunal administratif a rendu son verdict. Mélodie allait enfin obtenir son premier titre de séjour. Plus qu’une victoire, cette issue était pour cette ressortissante algérienne le début d’une aventure empreinte d’espoirs et loin de la peur de l’expulsion.
Le Sénat durcit l’accès aux aides sociales en imposant 2 ans de résidence en France

Le 18 mars 2025, les sénateurs ont adopté en première lecture une loi qui exige aux étrangers une résidence de 2 ans dans l’Hexagone pour accéder à certaines aides sociales. Aujourd’hui en phase d’étude à l’Assemblée Nationale, cette mesure ne cesse de faire réagir, mais qu’en est-il réellement ? Zoom. L’essentiel de cette nouvelle mesure Le 3 février 2025, Valérie Boyer a déposé au Sénat le texte n°299 (2024-2025). Celui-ci conditionne l’accès à certaines prestations sociales à une durée de séjour supérieure ou égale à 2 ans en France. Son application est prévue le 1ᵉʳ juillet 2026 pour permettre aux caisses de Sécurité sociale d’adapter leurs systèmes d’information. Quelles sont les prestations sociales concernées ? Les aides sociales prévues par cette nouvelle disposition sont : À qui s’applique la condition de deux ans de séjour régulier pour bénéficier des aides sociales ? Cette règle vise tous les étrangers non européens détenteurs d’un titre de séjour. Toutefois, certaines catégories de personnes en seront exemptes. Il s’agit : Cette disposition ne s’applique pas non plus aux ressortissants maghrébins, turcs, libanais et issus de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne et d’Amérique du Sud en raison des traités et conventions liant la France ou l’Europe avec ces pays. Par ailleurs, les étudiants étrangers disposant d’une carte de séjour n’ont pas besoin de justifier d’une présence de 2 ans en France pour accéder aux APL. Une mesure inspirée d’un article censuré de la loi Darmanin Cette disposition n’est pas totalement nouvelle puisqu’elle s’inspire de l’article 19 de la loi Darmanin, diffusée le 26 janvier 2024. Ce dernier imposait aux étrangers non européens 5 ans de séjour régulier ou 2 ans et demi d’activité professionnelle en France pour bénéficier des APL, des allocations familiales et de l’APA. Toutefois, il a été censuré par le Conseil constitutionnel qui le considérait comme cavalier législatif, n’ayant aucun lien avec son objectif initial. À titre de rappel, la législation en vigueur exige déjà aux étrangers une résidence continue de neuf mois sur le territoire pour pouvoir bénéficier des aides sociales. De nombreux sénateurs jugeaient la proposition initiale de cinq ans excessive et attentatoire à certains droits fondamentaux, ce qui a conduit à ramener cette durée à deux ans. « L’immigration coûte plus à la France qu’elle ne rapporte » Lors de sa déclaration présentant cette proposition de loi, la sénatrice Valérie Boyer a souligné la situation problématique de la France concernant l’immigration. L’Organisation de coopération et de développement économiques, dite OCDE, estime que cette dernière coûterait bien plus cher à l’Hexagone qu’elle ne devrait en rapporter. Pour étayer ces propos, Valérie Boyer rappelle qu’en 2023, les coûts liés à l’immigration étaient de l’ordre de 75 milliards d’euros. Selon elle, la mise en place de mesures visant à résoudre le problème est indispensable, car les comptes publics ne pourraient couvrir ces frais. Accès aux aides sociales : l’impact réel des 2 ans de séjour remis en question L’impact réel de cette condition de séjour pour l’accès à certaines prestations sociales suscite de nombreuses interrogations sur le plan financier. D’après la sénatrice Florence Lassarade, la nationalité des bénéficiaires d’allocations familiales n’est pas renseignée par la Caisse nationale. En ce sens, le calcul précis des frais versés aux foyers se révèle impossible. Le rapporteur de l’Union centriste Bruno Bitz estime aussi que cette nouvelle disposition nécessite la réévaluation des accords liant la France avec d’autres pays, car la marge de manœuvre est assez restreinte. Une proposition de loi qualifiée « d’inconstitutionnelle » Les oppositions de gauche estiment que la droite cherche à instaurer « une préférence nationale » dans la législation. Deux motions, visant à annuler cette proposition de loi, ont d’ailleurs été déposées : Pour la sénatrice Laurence Rossignol, il s’agit d’une mesure contraire aux principes qui constituent le socle de la République et inefficace dans la lutte contre l’immigration irrégulière. Elle souligne qu’une telle disposition risque surtout de fracturer la société qui a besoin de cohésion. Un avis appuyé par Ian Brossat qui considère que cette disposition vise simplement alimenter le débat public et n’aboutira à rien. La sénatrice de Meurthe-et-Moselle Silvana Silvani accuse même la majorité sénatoriale de « prendre le chemin du trumpisme ». Quant au sénateur Olivier Heno, il rappelle qu’il est possible de réguler l’immigration sans basculer dans l’extrême ni dans la xénophobie. Aucune prise de position du gouvernement Bien qu’il reconnaisse la pertinence de cette mesure face aux préoccupations des Français concernant l’immigration, l’exécutif s’est abstenu de prendre position. Le gouvernement estime que l’effet réel de cette mesure serait modeste au regard des ajustements conséquents qu’elle imposerait aux caisses de Sécurité sociale. Une décision fustigée par Ian Brossat qui la considère comme un signe de « lâcheté ». Les tentations de la gauche à faire tomber cette proposition de loi ont finalement été vaines, car la majorité sénatoriale a décidé de l’adopter le 18 mars 2025.
Nouvelles dispositions de la loi immigration : ce qui change pour les étrangers en France

La loi Darmanin ainsi que les nombreux décrets et circulaires diffusés après son entrée en vigueur marquent un tournant décisif dans la politique migratoire française. Examen de français, examen civique, respect des principes républicains, 3 à 7 ans de résidence ininterrompue… Les conditions de régularisation et de naturalisation connaissent un durcissement sans précédent. À cela s’ajoutent le renforcement des mesures d’éloignement et la prolongation de la durée de rétention en CRA à 210 jours. La signature du contrat d’engagement au respect des principes de la République, obligatoire pour rester en France Le 08 juillet 2024 marqué l’entrée en vigueur du décret n°2024-811. Celui-ci conditionne la délivrance de tout document de séjour (APF, titre de séjour temporaire, carte pluriannuelle et carte de résident) par la signature d’un contrat d’engagement aux principes républicains. Ce document formalise votre obligation à respecter les fondements de la République qui sont : En y apposant votre signature, vous affirmez votre engagement envers les valeurs républicaines, votre volonté d’intégrer la société française et votre attachement au pays. En cas de non-respect de vos engagements, votre titre de séjour peut vous être retiré ou refusé. L’administration française peut également vous délivrer une obligation de quitter le territoire. Cependant, il est à noter que le CEPR est facultatif, mais recommandé pour : 7 ans de résidence pour être admis au séjour Une circulaire destinée à remplacer celle du Valls voit le jour le 23 janvier 2025. Initié par le ministre de l’Intérieur, ce document modifie les conditions d’admission exceptionnelle au séjour. Désormais, les ressortissants étrangers devront avoir résidé en France pendant au moins 7 ans pour demander un premier titre de séjour “vie privée et familiale”. Une résidence ininterrompue de 3 ans est exigée pour les individus désireux d’être admis au séjour par le travail. Ils devront également justifier d’une activité professionnelle d’une durée supérieure ou égale à 12 mois dans un secteur en tension au cours des deux dernières années. Pour Bruno Retailleau, les personnes étrangères en quête de régularisation doivent être capables de prouver de façon concrète leur intégration à la société et leur volonté sincère de s’établir durablement sur le territoire. Il estime que l’AES n’est pas une voie ordinaire pour obtenir un titre de séjour, car comme son nom l’indique, il doit conserver un caractère strictement « exceptionnel ». Des associations comme La Cimade considèrent que ces nouveaux critères sont loin de représenter une solution. Selon elles, exiger une telle durée de résidence sur le territoire sans offrir de véritable sécurité administrative condamne les personnes étrangères à vivre dans la précarité, sous la menace constante d’un contrôle et d’une expulsion. Une telle exigence favorise aussi les situations d’exploitation au travail. La maîtrise du français, indispensable pour une intégration réussie Maîtriser la langue de Molière est désormais indispensable pour s’intégrer pleinement et légalement à la société française. La loi asile et immigration du 26 janvier 2024 conditionne la délivrance de titre de long séjour et de nationalité française par la réussite d’un test. Il faudra désormais avoir un niveau de français : Si ces dispositions sont prévues pour le 1ᵉʳ janvier 2026, Othman Nasrou, le secrétaire d’État chargé de la citoyenneté, entend avancer leur application au 1ᵉʳ juillet 2025. Un encadrement plus strict des conditions de naturalisation Une nouvelle circulaire Retailleau, cette fois portée sur les conditions d’accès à la nationalité française, naît le 05 mai 2025. Pour le ministre de l’Intérieur, devenir Français se mérite et l’administration doit se montrer particulièrement exigeante dans l’appréciation des dossiers de demande. Lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée à Créteil, Bruno Retailleau a affirmé que le sentiment d’appartenance prime sur l’ascendance. En plus de maîtriser la langue, les candidats à la nationalité française doivent justifier : Les individus souhaitant acquérir la nationalité française sont également tenus de passer un examen civique en plus de l’entretien d’assimilation auprès d’un agent de la préfecture. L’objectif est d’évaluer leur connaissance, leur compréhension et leur adhésion aux principes fondamentaux de la République. La durée de placement en CRA allongée à 210 jours La durée maximale de rétention administrative est désormais fixée à 210 jours. Cette mesure a été votée par le Sénat le 18 mars 2025 suite à la proposition du Gouvernement à réformer la loi asile et immigration pour mieux maîtriser les flux migratoires et renforcer la sécurité publique. D’après le ministre de l’Intérieur, une modification de la législation est nécessaire pour sauver des vies. Les étrangers considérés comme un danger pour la sécurité publique seront expulsés À l’heure où la sécurité est au cœur des débats, le Gouvernement français redouble d’efforts pour protéger ses citoyens. Aujourd’hui, l’insécurité et l’immigration sont plus que jamais considérées comme un tandem. Selon le ministre de la Justice Gérarld Darmanin, des ressortissants étrangers sont mis en cause dans : Si divers plans d’action comme le Plan Tranquillité à Marseille ont déjà été lancés, le Gouvernement entend simplifier l’éloignement des personnes de nationalité étrangère susceptibles de constituer une menace pour l’ordre public. Pour atteindre cet objectif, plusieurs dispositions ont été instaurées dont : Ces dispositions ont déjà porté leurs fruits, car plus de 20 000 personnes étrangères ont été expulsées en 2024.
Demande de nationalité française : nos conseils pour remplir le formulaire cerfa n°12753
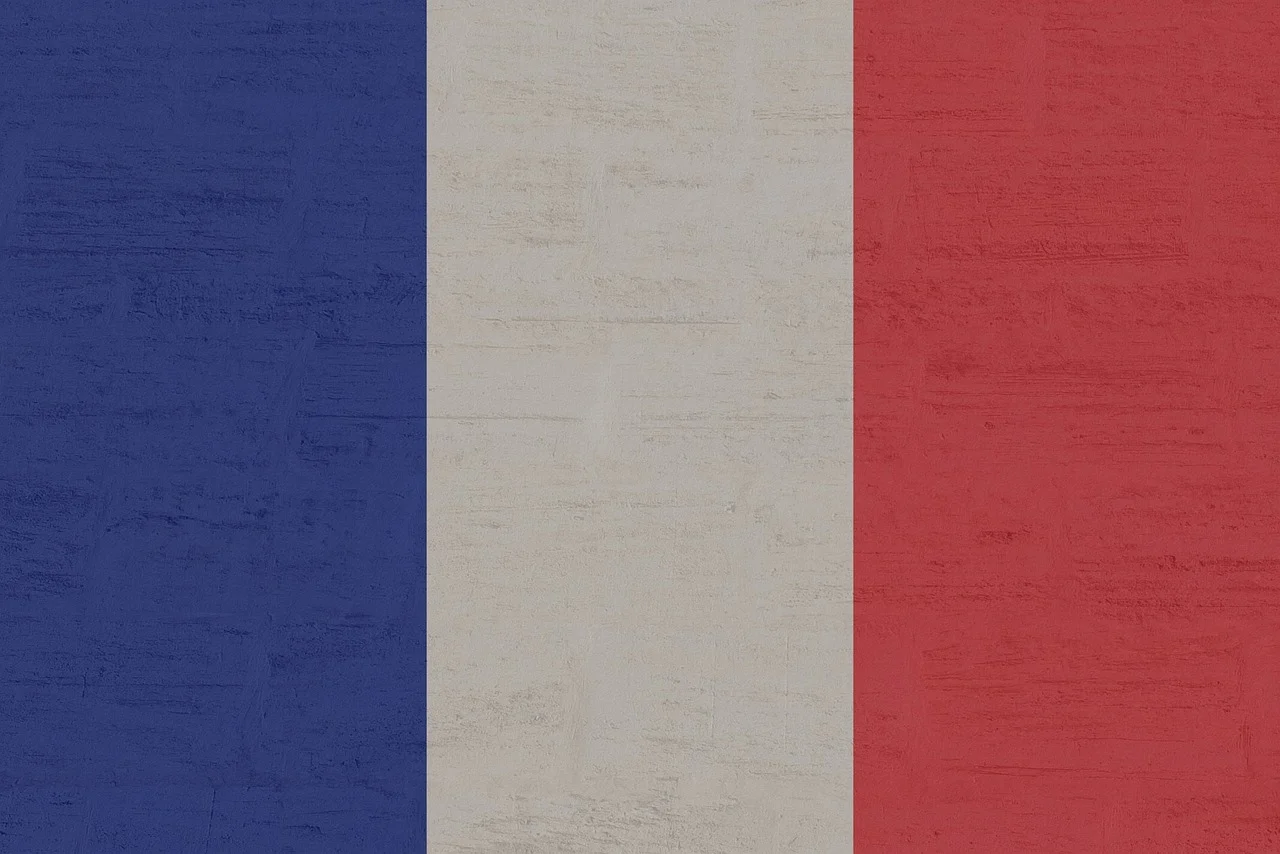
La procédure de demande de nationalité française obéit à une formalité stricte et rigoureuse. Outre le fait de remplir les conditions d’éligibilité, le candidat doit constituer un dossier complet, solide et conforme aux exigences de l’administration. L’une des pièces maîtresses de ce dernier est le formulaire cerfa n°12753. Ce document administratif regroupe toutes les informations du postulant, allant de son identité et de son état civil à sa situation et son parcours en France et à l’étranger. Une erreur, un oubli ou une incohérence et la requête risque un rejet. Pour éviter les faux pas, découvrez nos conseils pour bien ce formulaire et franchir sereinement cette étape décisive. Qu’est-ce que le formulaire cerfa n°12753 ? Le formulaire cerfa n°12753 est un document administratif indispensable pour constituer un dossier de demande de nationalité française par naturalisation ou par réintégration. Véritable point de départ de la procédure, il doit être rempli avec la plus grande attention. Rassemblant toutes les informations concernant le demandeur, ce formulaire remplit un double rôle. Il aide l’administration à s’assurer que le candidat remplit les conditions requises et simplifie l’instruction de sa demande. Une erreur ou une fausse déclaration peut entraîner le rejet de cette dernière. Qui doit remplir le formulaire cerfa n°12753 ? Le formulaire cerfa n°12753 s’adresse uniquement aux ressortissants désireux de devenir français résidant à l’étranger ou : Les personnes concernées doivent compléter ce formulaire en deux exemplaires et soumettre leur demande auprès de la préfecture de leur lieu de résidence ou du consulat français du pays dans lequel elles vivent. En revanche, les légionnaires et les étrangers domiciliés dans la métropole devront effectuer leur demande en ligne sur le site de l’ANEF sans avoir besoin de remplir ce formulaire. Quelles sont les informations à mentionner dans le formulaire cerfa n°12753 ? Comme mentionné précédemment, le formulaire cerfa n°12753*03 centralise l’ensemble des renseignements relatifs au candidat à la nationalité française. Ce document de 7 pages sert non seulement à évaluer si ce dernier remplit les conditions requises, mais aussi à faciliter l’analyse complète de sa demande. Les coordonnées et l’état civil La première étape consiste à remplir le formulaire de demande de nationalité française avec : Il est également nécessaire de joindre une photo d’identité et d’indiquer si vous souhaitez ou non franciser votre nom et votre (vos) prénom(s). La situation familiale Le formulaire doit contenir des renseignements précis sur votre situation familiale. Au-delà de votre état civil actuel, il est également nécessaire : Dans l’éventualité où vous vous êtes marié plusieurs fois, vous devez renseigner : Si tel n’est pas le cas, vous devrez simplement cocher la case dédiée à cet effet. Ensuite, vous devez remplir le tableau concernant l’identité de vos parents et de votre fratrie (même en cas de décès) ainsi que de vos enfants vivants. Le parcours Une fois toutes les parties concernant votre état civil et votre situation familiale renseignées, vous devez maintenant passer à votre parcours. Vous trouverez dans le formulaire de demande de nationalité française deux pages dédiées à votre expérience professionnelle et à vos domiciles en France et à l’étranger. Sur le tableau consacré à votre parcours professionnel, vous devez renseigner la date de début et de fin de l’activité, votre profession ainsi que le nom et l’adresse des employeurs. Sur celui consacré à vos domiciles, la date de début et de fin ainsi que votre adresse complète (incluant le pays, la ville ou la commune, le numéro et le nom de rue) doivent y figurer. Dans tous les cas, vous devez commencer par les informations les plus récentes. Les éventuels changements de situation La dernière page du formulaire cerfa n°12753*03 concerne les changements de situation personnelle et familiale en France ou à l’étranger qui sont survenus après le dépôt de votre dossier de demande de nationalité : naissance, décès, divorce, séparation, changement d’adresse, etc. Ce document doit être remis en deux exemplaires remplis, datés et signés à la préfecture ou au consulat de France de votre domicile. Les justificatifs originaux de ces changements ainsi que leur traduction doivent être joints à ce formulaire pour attester leur véridicité. Enfin, l’agent qui réceptionnera votre dossier devra remplir les parties concernant le récépissé de dépôt de déclaration de changement de situation et vous le remettre. Notez que vous devez demander un nouveau formulaire auprès de la préfecture ou du consulat si de nouveaux événements modifient votre situation après l’envoi de celui-ci. Quelle est la différence entre les formulaires cerfa n°12753*01, 02 et 03 ? Les formulaires cerfa n°12753*01, 02 et 03 concernent tous les trois la demande de nationalité française par naturalisation et par réintégration. Ils présentent les mêmes cases à remplir et à cocher. Leur différence réside dans les mises à jour et les modifications apportées au fil du temps. Le formulaire cerfa n°12753*01 Le formulaire cerfa n°12753*01 est la version originale du formulaire nationalité française. Il s’agit de la version la moins précise. À titre d’exemple, elle ne demande pas la date de dissolution du pacte civil de solidarité. Avec le formulaire cerfa n°12753*01, les candidats à la nationalité française n’ont pas non plus la possibilité d’indiquer s’ils souhaitent ou non recevoir par courrier électronique des demandes de pièces complémentaires ou des informations relatives au suivi de l’instruction de leur dossier. Le formulaire cerfa n°12753*02 Diffusé le 05 mai 2023, le formulaire cerfa n°12753*02 est la première mise à jour officielle du formulaire de demande de nationalité française. Elle s’adresse aux ressortissants résidant à l’étranger ou en Outre-Mer. Bien qu’elle soit fournie que son aîné, elle manque tout de même certaines informations dont la date de dissolution du PACS. Le formulaire cerfa n°12753*03 Comme son aîné, le formulaire cerfa n°12753*03 permet aux étrangers établis en Outre-Mer ou à l’étranger de demander la nationalité française par naturalisation ou par réintégration. Publié le 07 février 2025, c’est la version la plus précise et la plus récente du formulaire cerfa n°12753. En plus de contenir les informations citées plus haut, elle inclut aussi : En revanche, la mention portant sur
Samir et sa bataille pour rester en France

Samir B., 49 ans, vit à Nice depuis 2011. Originaire d’Algérie, il a reconstruit sa vie dans la métropole avec détermination. Technicien dévoué dans un grand hôtel, il enchaîne les journées de travail, paie ses impôts, respecte les lois, et surtout, veille sur son fils, Saïd. Tout bascule en 2022, lorsque ce père de famille a sollicité sa régularisation auprès de la préfecture qui lui a opposé un refus implicite. Une vie enracinée En plus d’être marquée par la durée, la vie de Samir en France est rythmée par les responsabilités, les engagements, les liens humains. Son fils, Saïd, désormais étudiant en France, dépend encore de lui financièrement. Tous deux forment un noyau familial uni, bien implanté. Sur le plan professionnel, Samir est en CDI depuis janvier 2020 dans la même société. Son employeur le soutient activement dans sa démarche. Il parle français, n’a jamais eu affaire à la justice, déclare ses revenus et paie ses impôts. Une demande balayée sans explication En vertu de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, Samir aurait dû obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’administration aurait dû considérer les preuves irréfutables de sa présence sur le sol français : relevés bancaires, avis d’imposition, bulletins de salaire, documents médicaux, etc. Mais aucune réponse ni même un récépissé provisoire ne lui a été transmis malgré une requête en bonne et due forme. Quatre mois après le délai réglementaire, il sollicite le cabinet d’avocats spécialisés en droit des étrangers pour former les recours nécessaires aux fins de faire valoir son droit au séjour. Une bataille administrative menée avec farouche et détermination Pour connaître les motivations de ce refus implicite, le cabinet a envoyé une demande d’explication par lettre recommandée avec accusé de réception à la préfecture qui en a pris la décision. Fidèle à son silence, elle n’a pas donné de réponse. Face à cette erreur manifeste d’appréciation du dossier de son client, le cabinet a saisi le Tribunal administratif. Il a élaboré en amont une stratégie de défense efficace et sur mesure pour légitimer le droit au séjour de Samir sur le sol français. L’argumentaire s’appuyait sur les preuves du parcours et de la situation de ce ressortissant algérien dans l’Hexagone. Après de longs débats, le Tribunal administratif a finalement décidé de donner à Samir son titre de séjour à l’issue de la saisine. Il a également reçu la somme de 1000 euros comme indemnisation liée à ses frais de justice. Pour ce père, cette décision marque un tournant décisif : celui d’un avenir enfin apaisé sur le sol français. Il peut désormais reprendre le cours de sa vie entouré des siens.
Le parcours de Tommy pour obtenir le droit de rester en France

Lorsque Tommy pose le pied à l’aéroport de Saint-Exupéry en septembre 1999, il avait 19 ans et rêvait de bâtir sa vie en France. Malgré les difficultés de la vie, ce ressortissant ivoirien n’a jamais lésiné ses efforts. Il renouvelle ses papiers, redouble d’efforts pour réussir ses examens et enchaîne les activités professionnelles pour subvenir à ses besoins. 22 ans d’intégration à la société française Tommy est entré sur le territoire français muni d’un visa long séjour valant titre de séjour, délivré dans le cadre de ses études. Il a obtenu sa première carte de séjour temporaire avec la mention étudiant en 2000 auprès de la préfecture lyonnaise. En 2016, il avait décroché un CDD au sein une société de nettoyage en qualité d’agent de service. Il y a travaillé à temps partiel, à hauteur de 72 heures par mois pendant un an. Par la suite, il a intégré une entreprise reconnue sur le marché français, spécialisée dans la construction, la transformation et la mise en œuvre de stratégies de développement en BtoB. Cet emploi en CDI lui octroyait un salaire mensuel de l’ordre de 2000 euros. Au-delà de son insertion professionnelle avérée, Tommy avait de la famille en France : sa tante, déjà naturalisée, ainsi que sa sœur et sa cousine, toutes deux en situation régulière. À cela s’ajoutent les liens sociaux qu’il a noués tout au long de séjour. Une requête sans réponse… Son titre de séjour étudiant étant arrivé à expiration en 2001, Tommy a été contraint de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Lyon. Le 28 avril 2022, il décide de franchir le pas et entame les démarches administratives. Pour appuyer sa requête, il prend le temps de rassembler toutes les preuves de sa présence habituelle et ininterrompue en France : Mais voilà, aucune réponse ne lui avait été transmise après le délai réglementaire de 4 mois, ce qui a donné lieu à un refus implicite de la préfecture. Une défense implacable et un soutien sans faille Tommy ne comprenait pas les motivations de cette décision défavorable. Malgré l’expiration de sa carte, il pensait avoir tout fait dans les règles et que sa situation lui permettait tout de même d’obtenir un titre de séjour correspondant à sa situation. Pour plaider sa cause, ce ressortissant ivoirien a fait appel au cabinet d’avocats en droit des étrangers. À l’issue de l’examen de sa situation, le cabinet a adressé une requête écrite à la préfecture afin d’obtenir des explications concernant ce refus. En l’absence de réponse de cette dernière, l’affaire allait être portée devant le tribunal administratif de Lyon. Tommy avait un dossier en béton. Son parcours parlait pour lui. Le cabinet avait d’ailleurs établi sa défense en s’appuyant sur son vécu en France. En plus de ses 22 années d’intégration à la société française, Tommy n’avait fait l’objet d’aucune condamnation, ne constituait pas de menace pour l’ordre public et ne vivait pas en polygamie. Aux termes de la saisine, le juge avait décidé de trancher en sa faveur. Il allait enfin obtenir son titre de séjour. Pour compenser ses frais de justice, Tommy avait reçu une indemnisation financière de l’ordre de 1000 euros. Pour lui, cette issue favorable marque un nouveau départ. Il pouvait enfin retrouver le sourire et reprendre le cours de sa vie sans craindre l’expulsion.
Décret du 22 janvier 2025 : le Premier ministre relance le comité interministériel de contrôle de l’immigration

Institué en 2005, le comité interministériel de contrôle de l’immigration connaît un nouvel élan grâce au décret du 22 janvier 2025. Le gouvernement a relancé cette instance pour mieux contrôler les flux migratoires et lutter contre l’immigration irrégulière. Quelles en sont les lignes directrices ? Focus. La France, le premier pays de délivrance de visas vers l’Europe Lors de son discours devant l’Assemblée nationale en janvier 2025, le Premier ministre François Bayrou a abordé les tensions croissantes liées à l’immigration sur le territoire français. Avec 2 858 083 demandes de visa accordées en 2024, la France devient le premier pays de délivrance de visas en Europe et tient la 3ᵉ place des pays de demandes d’asile. Pour le Premier ministre, la situation est unique. Des milliers de personnes en situation irrégulière se trouvent sur le territoire sans avoir engagé de démarche de demande d’asile ou de titre de séjour. Leur but est de traverser la Manche pour atteindre le Royaume-Uni. François Bayrou a souligné le souhait de l’État à appliquer fermement les lois. Il souligne l’importance de la mise en place d’une politique de contrôle, de régulation et de renvoi des étrangers dont la présence met en péril la cohésion nationale dans leur pays d’origine. L’essence du comité interministériel de contrôle de l’immigration Le décret n°2025-60, datant du 22 janvier 2025, relance le comité interministériel de contrôle de l’immigration initialement prévu par le décret du 26 mai 2005. Il en actualise les dispositions suivant les transformations de l’administration qui ont eu lieu depuis cette date. Qui sont les membres du comité ? Sous l’égide du Premier ministre, le comité interministériel de contrôle de l’immigration actuel est composé : Il est à noter que le Premier ministre se réserve le droit de convier d’autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité. Le secrétariat sera assuré par le directeur général des étrangers en France. Le fonctionnement du comité interministériel de contrôle de l’immigration Selon l’Article D.*123-1 du décret n°2025-60, il revient au comité interministériel de définir les grandes lignes de la politique gouvernementale en matière de gestion des flux migratoires. Un rapport doit être présenté au Parlement tous les ans. En plus d’assurer la préparation des travaux, des délibérations et du rapport du comité, le directeur général des étrangers en France s’assurera de l’application cohérente des décisions prises. Pour cela, il présidera également un comité des directeurs chargés de l’application de la politique gouvernementale concernant le contrôle de l’immigration et de l’asile. Parmi les membres de ce dernier, on note entre autres : Les priorités du comité interministériel de contrôle de l’immigration Le 26 février 2025, François Bayrou a réaffirmé les critères essentiels permettant aux étrangers de s’établir légalement en France : Il a également insisté sur l’importance des enjeux liés à la sécurité et à l’ordre public pour poser les bases des actions à venir. Le comité interministériel de contrôle de l’immigration va donc concentrer ses efforts dans la lutte contre l’immigration irrégulière. Les contrôles aux frontières, le droit d’asile, la politique de délivrance de visas et les mesures d’éloignement sont ses priorités. La Force frontière étendue sur toute la France Selon le Premier ministre, la Force frontière sera désormais mobilisée sur l’ensemble du territoire national afin de répondre à une pression migratoire jugée inédite. Mise en place en 2023 à l’initiative de l’ex-Première ministre Élisabeth Borne, cette unité regroupe des agents des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie. L’intervention des réservistes et des Sentinelles pourra également être sollicitée en cas de besoin pour une surveillance accrue des frontières françaises. Remaniement du droit d’asile François Bayrou a également abordé la problématique liée au droit d’asile lors de la première réunion du comité interministériel de contrôle de l’immigration le 26 février 2025. Selon lui, la France fait face à une situation inédite, car plus de 500 000 immigrés, incluant 160 000 demandeurs d’asile, ont été accueillis sur le territoire. Face aux attentes des Français en faveur d’une plus grande maîtrise des flux migratoires, le Premier ministre a souligné l’importance d’une réflexion pour préserver le sens véritable du droit d’asile. Renforcement des contrôles aux frontières de Mayotte Les côtes mahoraises font aussi l’objet d’un contrôle renforcé. Des ressources sont mobilisées pour reconstituer et améliorer la surveillance en mer et sur terre. Les radars endommagés par le cyclone Chido ont été remplacés et un système de surveillance par satellite a été mis en place. D’après les chiffres du Gouvernement, le nombre d’éloignements a déjà augmenté de 25 %. Intensification des mesures d’éloignement Le Gouvernement prévoit de modifier le cadre procédural pour permettre l’exécution immédiate des obligations de quitter le territoire. Les places en CRA seront également étendues au nombre de 3 000 d’ici à 2027 et des évolutions juridiques sont envisagées pour le maintien en rétention des personnes dangereuses jusqu’à leur expulsion. La politique des visas Le Premier ministre demande la réalisation d’un audit portant sur la politique de délivrance des visas. Pour rappel, près de 2,9 millions de visas ont été délivrés en France au cours de l’année 2024. Sophie Primas, la porte-parole du Gouvernement, estime qu’une telle quantité n’est pas nécessaire. Outre la procédure de demande et les conditions à remplir, la délivrance de visa se fera désormais en considération de la qualité de la coopération migratoire avec les pays d’origine, surtout en ce qui concerne la réadmission des étrangers expulsés. Les enjeux tendus dans les relations franco-algériennes L’Algérie a enfreint ses engagements et ses accords avec la France en refusant la réadmission de ses ressortissants expulsés du territoire. À 14 reprises, l’état algérien n’a pas répondu aux demandes des autorités françaises à accueillir l’auteur de l’attentat survenu à Mulhouse le 22 février 2025. Face à la situation, le Gouvernement entend engager un dialogue avec l’Algérie pour le réexamen des accords signés en 1968 dans un délai compris entre 4 à 6 semaines. En outre, la France va prochainement présenter aux autorités algériennes une liste d’urgence d’individus à expulser.

